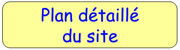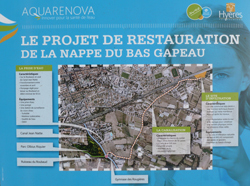Préambule
La présente page a pour bût d'étudier
:
-- le principe général de la réutilisation des
eaux usées traitées en sortie de station d'épuration,
-- la faisabilité éventuelle à appliquer à
la station d'épuration d'Hyères comme suggéré
par un certain nombre de personnes.
Ceci n'est qu'une réflexion personnelle
à partir d'une collecte d'informations et de documents regroupés
sur cette page.
Vos remarques, suggestions
et compléments d'informations sur ce sujet seront les bienvenues
pour la connaissance de tous.
Qu'est-ce
que la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)
?
Elle
consiste à recycler l’eau déjà utilisée
pour l’utiliser à nouveau, dans la majorité des
cas pour des usages différents.
Le film
ci-après vous permet d'avoir une vision globale du fonctionnement
d'une station d'épuration ainsi que de l'utilisation de la REUT.

En
quoi consiste-t-elle ?
La mise en œuvre de la REUT
commence à la sortie de la
station d"épuration après les traitements primaires
et secondaires.
A ce stade, dans la grande majorité des cas, les effluents
sont épurés à environ 95%, cependant,
divers micropolluants ne sont pas éliminés, car
lors de la conception des installations, les normes en vigueur
ne le prévoyaient pas.
Clic
sur les images ci-dessous --> Zoom
|
| 
|

|
|

|

|
|
| |
|
Comment
traiter les EU en fonction des différents usages projetés
?
En fonction des usages envisagés
à partir des eaux usées traitées qui seront réutilisées,
le traitement de celles-ci sera plus ou moins poussé.
Les technologies fréquemment mises en œuvre sont :
-- La filtration : filtration sur
sable, sur disques ou par membrane (ultrafiltration, osmose inverse)
-- La désinfection (Chloration, rayonnement ultra-violet, ozonation…)
Pour certains usages, notamment
ceux visant la potabilisation, des technologies complémentaires
sont mises en œuvre :
-- Adsorption sur charbon actif,
ozonation ou filtration par ultrafiltration membranaire (osmose inverse)
pour l’élimination des micropolluants et
pour inactiver les bactéries, virus et parasites.
-- Nanofiltration, osmose inverse, électrodyalyse pour l’élimination
de la salinité et de certains minéraux.
Avant d’être envoyée
dans le réseau, l’eau subit enfin des contrôles de
qualité et une chloration, assurant un effet désinfectant
qui dure dans le temps afin que la qualité de l’eau obtenue
ne se détériore pas durant la distribution.
Pourquoi réutiliser les
eaux usées ?
Depuis quelques années, nous entrons
dans une période ou l'eau devient de plus en plus rare dans certaines
régions et dans certains pays avec des sécheresses de
plus en plus nombreuses.
La REUT est une approche logique pour répondre aux défis
mondiaux de l’eau.
Elle permet notamment de limiter
les prélèvements dans les ressources en eau brute de bonne
qualité qui ne nécessitent qu'un simple traitement de
stérilisation.
Tant qu'il y a de l'eau facilement disponible, on rejette les eaux usées
traitées en sortie de station d’épuration dans l’environnement
sans chercher à les revaloriser, car c'est plus facile et celà
a un coût négligeable.
La gestion des risques sanitaires et environnementaux doit servir de
pierre angulaire, afin de sécuriser l’ensemble des usages
potentiels. Il s’agit donc d’une solution inscrite dans
la transition vers une économie circulaire qui permet de s'adapter
au changement climatique et à la transformation des modes de
consommation.
Comment
mettre en place un projet de réutilisation de l'eau (REUT) ?
Les projets de réutilisation
des eaux usées sont de plus en plus populaires en raison principalement
de la raréfraction des ressources en eau, des avantages économiques
et environnementaux qu’ils offrent.
Pour mettre en place un tel projet, il convient de déterminer
:
- les sources d’eau disponibles ; eaux usées traitées,
eaux de pluie etc ...
- le lieu qui finalisera le traitement des eaux usées avant leur
mise en distribution,
- les différents types d'utilisation des eaux usées traitées
qui conditionneront les différents traitements à réaliser,
- les lieux et l'importance des stockages à prévoir avant
leur mise en distribution,
- les réseaux et les installations à mettre en place pour
amener ces différents types d'eaux recyclées jusqu'aux
lieux de desserte.
- le coût des investissements, des dépenses de fonctionnement
et de l'entretien des installations.
La
durée de constitution d’un dossier de REUT est rarement
inférieure à 5 ans. Il peut se passer jusqu’à
15 ans entre la première idée du projet et le dépôt
du dossier de demande d’autorisation.
Face à de tels délais, la réussite de certains
projets peut sans doute être gênée par l’évolution
rapide du cadre réglementaire entre 2010 et 2017.
Réf --> Cerema – Économie et partage
des ressources en eau – Juin 2020 + page 12/23
Clic
sur les images ci-dessous --> Zoom
| |

https://www.umontpellier.fr/articles/ces-pays-qui-recyclent-les-eaux-usees-en-eau-potable
|
|
|
|
|
|
|
Peut-on boire l'eau usée traitée ?
--- En sortie de la station d'épuration,
l'eau usée traitée n'est pas consommable. Un traitement
spécifique doit être réalisé afin de
la rendre potable.
--- Bien
que celà puisse être choquant au premier abord, de
nombreuses villes dans différents pays en manque
de ressources distribuent de l'eau potable après les traitements
nécessaires en complément aux ressources locales.
Exemple
1
L'exemple le plus concret et le plus ancien est
notamment le cas de la ville de Windhoek
(Namibie). Elle a été la première usine
au monde à développer ce procédé vers
1968. Celle-ci alimente en
eau potable jusqu'à 35 % de
la consommation de la ville de 400 000 habitants (25 000 m3/j)
à partir des eaux usées recyclées. Ceci permet
de pallier au stress hydrique local.
L'usine
de Windhoek utilise un procédé appelé réutilisation
directe de l'eau potable (DPR) qui élimine les polluants
et les contaminants des eaux usées grâce à
un processus à barrières multiples avant d'être
introduite sous forme d'eau purifiée et sûre dans
l'approvisionnement en eau potable, le tout en l'espace de 24
heures, ce qui réduit le temps et la distance entre le
traitement et la consommation.
( https://www.nature.com/articles/d44148-023-00350-6
)
Exemple
2
En France, le seul projet en cours de "potabilisation"
d’eaux usées traitées, est celui du Programme
Jourdain, en Vendée. L'eau est épurée
dans une
unité d'affinage, puis rejettée dans une zone
de transition végétalisée en amont du lac
de Jaunay et non directement dans le circuit de distribution d’eau
: c’est la "potabilisation indirecte". |

Film explicatif - (Clic
sur l'image)

Schéma du programme
Jourdain - (Clic
!)
|
|
Maintien du débit d'étiage pour les cours d'eau
La REUT : avantages, risques
et solutions
La REUT est une des réponses face au risque sécheresse.
Cependant le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE)
comporte des points de vigilance sur son développement.
Quels risques présente
cette technique ?
Cette technique est souvent
mise en avant dans le contexte du changement climatique.
Il faut cependant examiner ses avantages et les risques afin que
son usage soit adapté, et que son développement
n’engendre pas de maladaptation. Si elle peut contribuer
à économiser l’eau en réduisant les
prélèvements directs sur la ressource, tout en limitant
la pression polluante constituée par le rejet des eaux
usées traitées au cours d’eau, elle peut présenter
un certain nombre de risques :
--- Le premier risque est l’assèchement
du cours d’eau. Il faut rappeler que ces eaux non conventionnelles
ne constituent pas une nouvelle ressource. De plus, la plupart
des eaux de réutilisation produisent de fait leur évaporation
dans l’atmosphère. On interrompt donc le cycle. En
effet, les eaux usées traitées font partie du cycle
hydrologique car elles sont restituées au cours d’eau.
Elles peuvent même représenter une forte proportion
du débit de la rivière, jusqu’à 70%
pour un cours d’eau en étiage ! Leur réutilisation
peut donc avoir un impact considérable en termes d’assèchement
d’un cours d’eau. Les conséquences peuvent
être sévères à l’échelle
d’un bassin versant qui verrait cette pratique se multiplier,
alors que les rejets d’une station représentent une
part significative des débits des cours d’eau. Cela
entraînerait l’assèchement d’un territoire
et des usages en aval en comprometant les besoins de l’écosystème
aquatique.
--- Un autre risque est l’échec
en termes de maintien ou de transformation vers des usages durables.
Si l’eau réutilisée vient maintenir des usages
qui n’ont pas au préalable fait un effort de sobriété,
au sens d’une véritable transformation de pratiques,
la réutilisation des eaux usées traitées
n’aura d’effet qu’à court terme et ne
permettra pas une adaptation à moyen ou long terme à
la rareté de la ressource et donc le maintien de pratiques
durables.
--- Le 3ème risque est d’agir à
l’encontre d’une atténuation du changement
climatique qui vise à réduire les sources de gaz
à effet de serre. Car la réutilisation des eaux
non conventionnelles nécessite la construction d’infrastructure
pour le stockage, des canalisations pour l’acheminement
de ces eaux, sans compter l’entretien de ces nouveaux équipements.
Ces eaux exigent également, dans la plupart des cas, un
traitement complémentaire à celui de la station
d’épuration ainsi que de l’énergie pour
les acheminer. Toutes ces opérations sont coûteuses
et énergivores et entraînent l’extraction de
matériaux supplémentaires.
--- Enfin,
le risque sanitaire est réel.
Les eaux usées traitées étant riches en composants
organiques, les eaux stockées pour la réutilisation
courent un risque d’eutrophisation et de développement
de cyanobactéries car la réutilisation
en flux continu est improbable. Il y a donc un risque sanitaire
qui compromet leur utilisation ou la rend difficile, y compris
pour des usages agricoles.
Dans quels cas cette technique semble-t-elle adaptée ?
Il
y a plusieurs prérequis pour que cette technique soit pratiquée
en évitant les risques mentionnés ci-dessus :
--- Le cours d’eau
doit avoir un débit suffisant pour que la suppression du
rejet d’eaux usées traitées ne l’affecte
pas, ni sa faune et sa flore, en particulier en période
d’étiage.
--- Il faut également veiller à ce que les autres
usages en aval ne soient pas pénalisés par la réutilisation
du rejet de la station d’épuration pouvant entraîner
un moindre débit de la rivière. De ce point de vue,
un projet de réutilisation des eaux usées sera davantage
pertinent encore en aval du bassin versant, à proximité
du littoral ; pour autant, il ne faut pas négliger que
les populations de poissons ont besoin d’apports suffisants
en eau douce y compris les écosystèmes marins pour
bien fonctionner.
--- Tout projet de
réutilisation des eaux usées devrait donc faire
l’objet d’une étude hydrologique tenant compte
des autres projets du même type sur le bassin versant, afin
de tenir compte des effets cumulés.
--- L'étude
hydrologique repose sur des mesures du débit du cours d’eau,
de la pluie et sur des méthodes d’extrapolation en
tenant compte du changement climatique en cours. L’étude
doit permettre de tenir compte du partage avec les autres usagers
de la ressource en eau, qui risqueraient de pâtir de la
baisse du débit, mais aussi de préserver un débit
suffisant pour le milieu naturel, notamment dans les milieux humides
à protéger.
--- Par ailleurs, comme
déjà évoqué et comme le prévoit
la réglementation, il faut au préalable prouver
que les usages de l’eau ont évolué en profondeur
vers plus de sobriété, avant la mise en œuvre
d’un projet de réutilisation des eaux usées
traitées.
--- Il faut également
limiter les opérations complémentaires nécessaires
à la réutilisation des eaux usées traitées
lors du stockage des eaux. Un usage à proximité
de la station d’épuration permet d’éviter
un transport coûteux et énergivore.
|
| STEP
DE L'ILE DE PORQUEROLLES |
|
| *** Vers
1920
Depuis la création du village en 1920, la plus grande partie
des effluents domestiques étaient déversés
directement en mer, au niveau du port.
*** En 1975
La station d'épuration de type " biologique sans décantation
" a été mise en service en juin.
Elle a une capacité nominale de 4000 eq.hab. pour une charge
nominale de 1000 m3/j. Les effluents sont alors dirigés
vers les " Gorges du Loup "(3).
*** En 1981
La station rejette alors dans le lagunage naturel qui est mis
en service en septembre.
Il se compose de 3 bassins en série.
- La première lagune à "microphites" (algue
microscopique unicellulaire) a une surface utile de 4000 m2 pour
une profondeur de 1 m. env.
- La deuxième lagune composite comprend une zone à
"microphites" de 1300 m2 (P=1 m.) et une zone à
macrophytes (plantes aquatiques)
de 700 m2 d'une profondeur de 0,30 m env.
- La troisième lagune à "macrophytes"
a une surface utile de 4000m2 pour
une profondeur de 0,30m env.
- L'ensemble des lagunes permettent un stockage de 6 800 m3.
- Le temps de séjour dans les bassins est de 30 jours environ.
Ces lagunes jouent alors le rôle de traitement tertiaire.
(4)
En sortie de la 3e lagune, un bloc technique assure la mise sous
pression des eaux nécessaire à leur distribution
et surtout leur filtration sur des filtres à sable, essentielle
pour prévenir le colmatage du dispositif d’irrigation
goutte-à-goutte.
Ce bloc d’amenée d’eau est composé de
:
• une bâche de stockage,
• deux pompes de mise sous pression,
• un système de filtration à sable autonettoyant
par inversion de flux,
• des ouvrages de maçonnerie associés.
(5)
Les eaux usées traitées sont alors mises à
disposition du Conservatoire botanique national méditerranéen
afin de les utiliser pour l'irrigation des vergers. Cette solution
permet de fortement diminuer les volumes pompés dans la
nappe. (6) et
(7)
Les eaux usées traitées non réutilisées
sont rejetées par surverse de la dernière lagune
dans la « Garonne », ruisseau à écoulement
intermittent jusqu’au port (9).
Dans la pratique, sauf à l’exutoire des lagunes,
la Garonne ne présente pas d’eau libre en période
estivale.
Des
batardeaux sont également aménagés sur son
parcours afin de freiner l'écoulement des eaux vers le
port et pour favoriser l'infiltration de celle-ci dans le sol.
Cependant, dans les faits, cette solution amène
au croupissement des eaux qui deviennent verdatres et dégagent
des odeurs nauséabondes en bordure du chemin.
Les lagunes, dont le fond n'est pas étanche, doivent être
nettoyées tous les 3 à 4 ans. Durant cette période
celles-ci sont vidées et les effluents sont dirigés
vers les " Gorges du Loup ".
Actuellement, la station d'épuration
traite en période de pointe environ 1000 m3/jour
(4000 Eq.hab).
Le réseau d’eau usée traitée s’ajoute
au réseau d’eau de la nappe également utilisé
à des fins d’irrigation. Les deux réseaux
d’eau sont clairement distingués par des tuyaux de
couleurs différentes.
La chronologie
de la REUT de l'île de Porquerolles est rappelé sur
la fiche (2) et
le bilan sur la (10).
|
|
 3 - Evacuation initiale
des eaux usées vers les Gorges du Loup
3 - Evacuation initiale
des eaux usées vers les Gorges du Loup
Zoom
- clic ! |
 4 - Implantation de
la station d'épuration et des 3 lagunes
4 - Implantation de
la station d'épuration et des 3 lagunes
Zoom
- clic ! |
 5 - Synoptique du
bloc technique de mise sous pression et filtration - Zoom
- clic !
5 - Synoptique du
bloc technique de mise sous pression et filtration - Zoom
- clic ! |
|
 7 - Vue d'ensemble
STEP-conservatoire botanique et vergers
7 - Vue d'ensemble
STEP-conservatoire botanique et vergers
Zoom
- clic ! |
|
 9 - Evacuation du
trop plein des lagunes dans la Garonne
9 - Evacuation du
trop plein des lagunes dans la Garonne
Zoom
- clic ! |
 10 -Profil de la démarche
de la REUT à Porquerolles
10 -Profil de la démarche
de la REUT à Porquerolles
et points clés du bilan
Zoom
- clic ! |
|
|
CONCLUSION
La station d'épuration
des eaux usées de l'île de Porquerolles est
l'exemple parfait de la conception dès le départ,
de la volonté de mettre en oeuvre la REUT dans un
contexte de pénurie d'eau douce sur l'île.
Avec la pénétration du biseau salé
dans la nappe phréatique et des besoins en eau d'irrigation
pour le Conservatoire botanique national méditerranéen,
cette technique permet d'optimiser les ressources disponibles
sur l'île.
|
|
|
| Caractéristiques
-- La station d'épuration
d'Hyères - Carqueiranne se
situe au lieu dit l'Almanarre.
-- Elle est de type physico-chimique et biologique pour la filière
eau. Elle est composée de deux bassins tampons situés
après le traitement physico-chimique et après le
traitement biologique sur les eaux usées traitées.
Avant le prétraitement, un by-pass est présent.
Suite à un arrêt préfectoral, les micropolluants
en sortie de station doivent faire l'objet d'un suivi régulier.
-- Une conduite de 1000m en
sortie de STEP, de 700 mm de diamètre rejoint un poste
de surpression à proximité de la plage. Celui-ci
refoule les effluents jusqu'à
1500 m. du rivage, dans un émissaire de 700 mm dont
l'extrémité est immergé à environ
10 m. de profondeur. Le débit maximum est de 2500 m3/h.
--- Un suivi de la qualité du milieu marin au droit du
rejet des stations de traitement des eaux usées a été
réalisée en décembre 2012 (dossier
joint).
La mise en service de la
station a été réalisée vers la fin
de l'année 2010.
Capacité nominale station : 121 600 EH
Charge maximale en entrée : 79 300 EH
Périmètre de collecte sur les communes d'Hyères
et Carqueiranne.
En 2017 : 22 300 abonnés.
EN
2021 |
 Cliquez sur
l'image pour accéder au document original
Cliquez sur
l'image pour accéder au document original
|
Volumes entrants
: 5 192 698 m3
Capacité nominale
--Volumes : 27 000 m3/j
-- DBO5 : 7 300 kg/j
-- DCO : 18 900 kg/j
-- MES : 10 700 kg/j
Charges moyennes reçues
-- Volume : 14 227 m3/j
-- DBO5 : 2 789 kg/j
(2789 kg/14227 m3 = 0,2kg/m3 -->200g/1000 l.
= 0,2mg/l
|
Rendements
épuratoires
-- DBO5 : 96,9 %
-- DCO : 92,8 %
-- MES : 97,2%
(100% = rendement parfait)
Quantité de boues produites : 1 123 tonnes Ms (matières
sèches)
(90% incinération & 10% compostage)
|
DBO5
: demande biologique en oxygène – représente
la fraction biodégradable de la pollution
DCO : demande chimique en oxygène – représente
la pollution globale des eaux usées.
MES
: matières en suspension – représente
la pollution physique des eaux usées.
|
Fonctionnement
normal
-- Comme indiqué ci-dessus le fonctionnement
de la station d'épuration est très satisfaisant
avec des rendements épuratoires avoisinant les 95%. Il
n'y a donc pas de risque de pollution pour les rejets en mer,
si ce n'est l'apport d'eau douce .... comme pour les cours
d'eau avoisinants dans la rade d'Hyères (Le Gapeau,
Le Roubaud, Le Pansard et le Maravenne).
-- Cette eau pourrait donc être "réutilisable"
dans son principe, pour différents usages dans les classes
de qualité C et D.
Fonctionnement
lors des orages
Lors des orages, l'ensemble du réseau des
eaux usées se trouve en surcharge. Celà est dû
:
1 - Aux mauvais raccordements :
Raccordement des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées
(gouttière, descente de garage, avaloir de la voirie ....).
Regard de visite et boîte de branchement non étanche.
2 - A un réseau
non étanche :
Défaillance du réseau collecteur ou du réseau
de branchement (perforation, cassure, fissure, effondrement, joint
mal positionné, infiltration, ovalisation, poinçonnement,
corrosion, déboîtement, pénétration
de racines, inversion de pente, branchement pénétrant
....)
Tout ceci augmente le volume qui arrive à la STEP. Lorsque
le niveau de la nappe phréatique monte ce problème
est encore plus sensible en zone littorale comme à Hyères
ou les collecteurs sont implantés jusqu'à 4 m. de
profondeur.
3 - Conséquences
:
- Montée en charge du réseau,
- Débordement du réseau vers le milieu naturel en
différents lieux (déversoir d'orage ou trop plein
dans les stations de relèvement et refoulement ),
- Transfert des excédents en amont de la STEP vers un bassin
d'orage, puis ensuite les excédents vont être refoulés
directement en mer sans traitement possible.
- Augmentation de la consommation électrique des postes
de refoulement,
- Augmentation des réactifs utilisés pour le traitement,
- Diminution de la qualité du traitement,
- Risque de départ de boues.
|
 Implantation de la STEP
de l'Almanarre
Implantation de la STEP
de l'Almanarre
à proximité du golfe de Giens - (zoom)
|
|
|
| RÉUTISATION
DES EAUX USÉES TRAITÉES A LA STEP DE L'ALMANARRE |
Principe de base
-- En premier lieu, il faut répertorier
les besoins permanents en eaux usées recyclées à
proximité de la STEP.
-- La difficulté va être de synchroniser les volumes
sortant de la station 24h/24h et 365 jours par an à ceux
de la demande pour les différentes utilisations envisagées.
-- Il sera donc indispensable de créer un bassin "tampon
de stockage" avec un surverse afin d'évacuer l'excédent,
d'optimiser le volume réutilisable ..... et surtout de
trouver une zone pour le réaliser !
-- Il faudra ensuite mettre en place une station de pompage qui
refoulerait dans un réservoir en hauteur pour une desserte
en gravitaire dans un réseau d'adduction spécifique
afin de distribuer ces eaux vers leurs destinations. Sur certains
tronçons, la pose d'un réseau "d'eau non potable"
à proximité d'un réseau "d'eau potable"
comporterait des risques de confusion lors de l'exploitation des
canalisations.
-- La principale utilisation au regard du volume à réutiliser
serait probablement l'irrigation pour l'agriculture.
-- L'ensemble de ces installations impliquerait des investissements
importants, ainsi que des coûts de fonctionnement et d'entretien.
Comment
et où réaliser cette installation
1 - Utilisation directe
1a - Bassin tampon et station de pompage
Si nous prenons comme exemple, un stockage d'une journée
moyenne de 15 000m3 :
En refoulant les eaux usées, on peut imaginer de créer
"discrètement" un bassin sur environ 15 000m2
"en haut" de l'ancienne décharge publique qui
culmine à 20 m. NGF environ. A cette altimétrie,
la pression utilisable au niveau zéro en pied du bassin
serait de l'ordre 1,5 bar et de ..... plus grand chose quelques
kilomètres plus loin !
1b - Réservoir en hauteur
Il faudrait alors créer un réservoir spécifique
"quelque part" vers l'altitude 100,00 m. NGF environ,
afin d'avoir une pression suffisante d'utilisation.
1c - Conduites de distribution
Comme la STEP est loin de ces zones là, il faudra investir
pour créer un nouveau réseau qui viendrait en "doublon"
:
-- avec celui du canal
de Provence pour l'irrigation comme le figure le
plan d'implantation ci-joint.
-- avec l'eau du "Canal Jean Natte/Roubaud"
(vers le lycée
agricole) pour la réalimentation de la nappe phréatique
qui existe depuis mars 2016. Celle-ci se
fait actuellement de novembre à avril. Documentation
ci-jointe.
1d - Coût pour les usagers
Il semble évident que les m3 qui arriveraient aux demandeurs
destinataires ne seraient pas "gratuits" au regard des
frais de fonctionnement et des investissements réalisés.
2 - Utilisation sur
le principe du lagunage (idem Porquerolles)
2a - Stockage
En gravitaire, si nous voulons reproduire le principe de l'épuration
lagunaire, il faudrait :
-- une première lagune
à "microphites" (algue microscopique unicellulaire)
d'une surface utile de 27000 m2 pour une profondeur de 1m env.
(surface idem capacité maxi de la STEP),
-- une deuxième lagune composite comprenant une zone à
"microphites" de 8800 m2 (P=1m) (1300m2/4000m2x27000m2)
et une zone à macrophytes de 4800 m2 (700m2/4000m2x27000m2)
d'une profondeur de 0,30m env.
-- La troisième lagune à "macrophytes"
(plantes aquatiques) aurait une surface utile de 27000 m2 pour
une profondeur de 0,30m env. (surface idem capacité maxi
de la STEP),
--
L'ensemble des lagunes permettrait un stockage de 46 000 m3 sur
7 ha environ.
-- Le temps de séjour et de transit dans les bassins serait
de 30 jours environ.
-- Ces lagunes joueraient alors le rôle de traitement tertiaire.
2b
- Terrassement
L'aménagement des lagunes nécessiterait des terrassements
sur 7 hectares environ, à une profondeur supérieure
à un mètre (sous
le niveau de la mer) afin de permettre
un écoulement en gravitaire entre les 3 lagunes. Celà
représente un volume d'environ 100 000 m3 (70 000m2 x 1,40m).
2c
- Station de pompage et filtration
A partir de ce stade du traitement des eaux usées traitées,
nous en revenons au point 1a
évoqué ci-avant ; à savoir
:
1a - Bassin tampon et
station de pompage
1b - Réservoir en hauteur
1c - Conduites de distribution
1d - Coût pour les usagers
2e
- Importance du projet
Même si nous prenons l'hypothèse d'un recyclage partiel
et non total de eaux usées traitées en sortie de
la STEP, la démarche sera similaire.
2e
- Faisabilité du lagunage
La réalisation d'un lagunage va probablement se heurter
aux problèmes suivants :
-- Autorisations administratives pour envisager ces travaux,
-- Aménagements en contradiction probable avec ce "site
classé" et l'OGS,
-- Incertitudes techniques en raison de travaux de terrassement
et d'exploitation en dessous le niveau de la mer,
-- Les
lagunes, dont le fond n'est pas étanche, devront être
nettoyées tous les 3 à 4 ans.
-- Perturbation de l'écosystème environnant,
-- Dégradation de l'image du double tombolo,
-- Augmente les investissements et les frais d'entretien par rapport
à "l'utilisation directe" en
sortie de station.
-- Il faut toujours rejeter les effluents non réutilisés
en mer par l'émissaire existant.
|
|
N'oubliez
pas de "cliquer" sur les textes en bleu qui sont soulignés
pour accéder à des documents complémentaires.
|
Sources
d'informations
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/05/synthese-etude-reut-vf.pdf
https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/6205/1/IN1274-669%20Almanarre%20-%20Stabilit%C3%A9%20%C3%A9missaire%20-%20Ind%203.pdf_1215Ko
https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/6205/2/IN669-1274_Etude%20de%20courantologie%20et%20de%20dispersion.pdf_3771Ko
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_06_panorama_reut_pour_edition_vdef-1.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/web_rapport_activites_tpm_2017.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/rapport_annuel_eau_assainissement2020.pdf
https://metropoletpm.fr/actualites/aquarenova-un-projet-innovant-restaurer-ressource-eau
https://moncompteclient.canaldeprovence.com/_map/front/?m=res
https://eau.seine-et-marne.fr/fr/actualites/reutilisation-des-eaux-traitees-issues-des-stations-depuration
https://www.nature.com/articles/d44148-023-00350-6
https://www.eau-seine-normandie.fr/reutilisation-eaux-usees-traitees
https://www.mitawatertechnologies.com/fr/ressources/articles-techniques/filtration-tertiaire-pour-le-traitement-des-eaux-usees-vue-densemble-reglementations-technologies/
Page
mise à jour le 15/12/2024
|
|